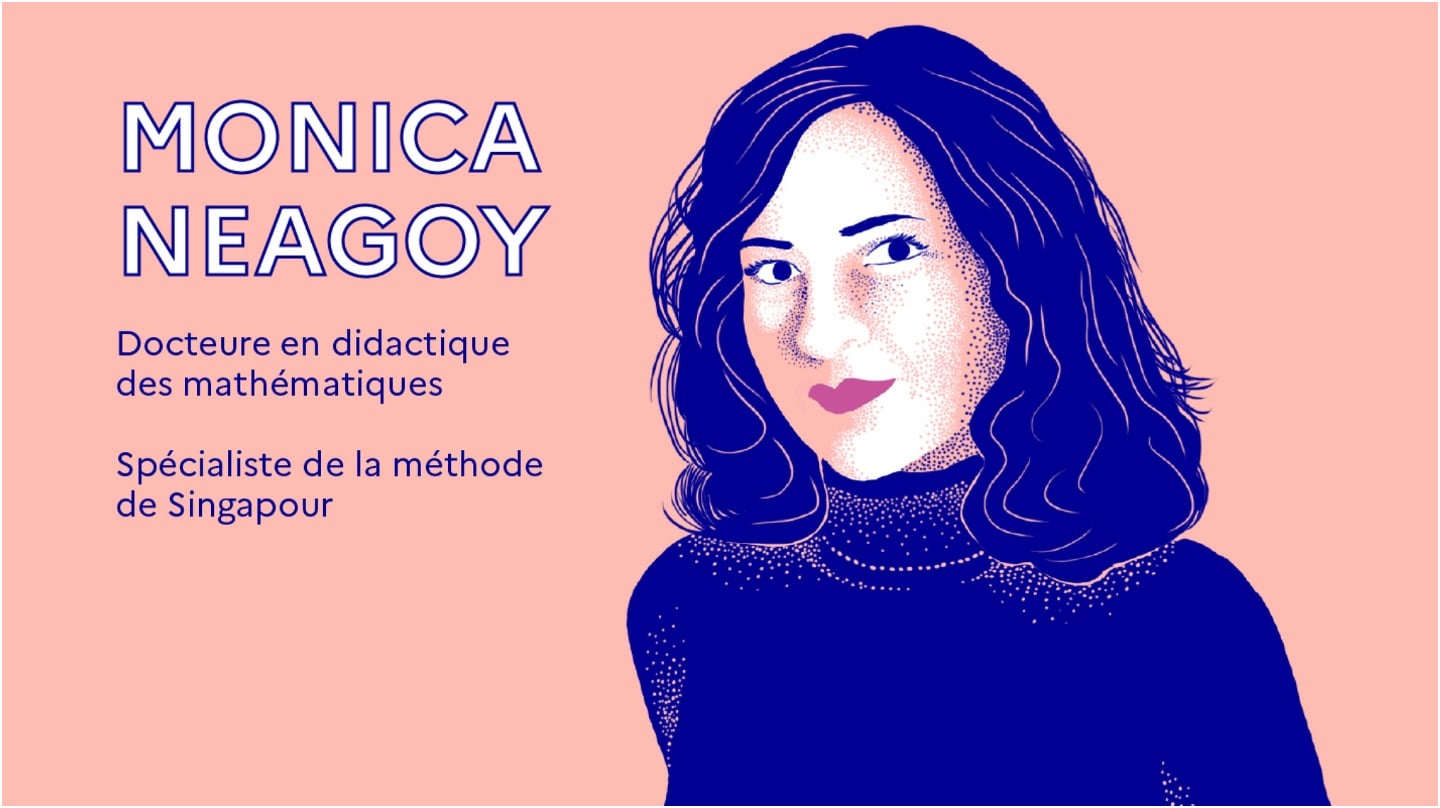Qu’appelle-t-on les « mathématiques de Singapour » ?
Les Singapouriens ont une réponse très intéressante à cette question. Pour eux, il n’existe pas de « mathématiques de Singapour ». C’est le nom que le monde donne à ce qu’ils font, alors qu’eux estiment simplement faire « des mathématiques de qualité ».
D’excellentes mathématiques, certes, qui les classent en tête de tous les classements mondiaux :
TIMSS depuis 1995,
Pisa depuis 2009.
Ces mathématiques placent l’enfant au centre, en tenant compte de sa maturité, de sa curiosité, et surtout du plaisir qu’il a naturellement avec les nombres et les formes, c’est-à-dire l’arithmétique et la géométrie. Elles veillent à le stimuler et ne pas le laisser décrocher.
Le ministère de l’Éducation singapourien a choisi en 1997 une devise que j’aime beaucoup : « Thinking Schools, Learning Nation ». Si nous apprenons à nos enfants à réfléchir, à trouver un sens à ce qu'ils font, ils pourront tout apprendre. Et c’est mon message essentiel : nous devons remettre la réflexion au cœur des mathématiques.
Comment est née la méthode de Singapour ?
Singapour est devenu indépendant en 1965. À partir des années 80, Singapour a créé son propre curriculum en important des pédagogies qui avaient fait leurs preuves ailleurs dans le monde, y compris depuis la France.
Ce qui fait vraisemblablement la différence, c’est qu’ils ont parfaitement suivi les consignes, là où finalement elles ne sont pas toujours appliquées à la lettre dans leur pays d’origine.
Ils se sont aussi appuyés sur les retours du terrain, pour, petit à petit, polir leur ouvrage jusqu’à la perfection. Une fois qu’ils ont trouvé une formule ne laissant aucun élève de côté, bon ou moins bon, ils l’ont appliquée systématiquement dans toutes les écoles, pour tous les niveaux.
Quels sont les principes fondamentaux de cette méthode ?
Elle repose d’abord sur l’approche « concrète, imagée, abstraite ». Cette approche s’inspire du travail du psychologue Jerome Bruner, qui a défini trois stades du développement intellectuel : « énactif, iconique, symbolique ». Les Singapouriens ont clarifié la formule en « concret, imagé, abstrait » pour une meilleure compréhension, par le professeur comme par l’élève. En France, nous traduisons maintenant cette formule, dite « CIA », en « manipuler, représenter, abstraire ».
Nous, les adultes, sommes très à l’aise avec des symboles sur une feuille de papier, et nous oublions que les enfants, eux, ne le sont pas encore. La méthode singapourienne permet d’accompagner l’enfant progressivement du concret perceptible vers l’abstraction mathématique. Chaque étape a son importance pour bien comprendre les concepts.
Toutes les leçons – que ce soit l’addition, les fractions, la proportionnalité, etc.- commencent dans le réel, dans le quotidien de l’enfant, avec des manipulations d’objets, des mises en scènes de situations. Cette phase, très appréciée des enfants, est déjà en partie présente dans nos classes.
La phase de manipulation est suivie d’une phase de représentation qui peut prendre différentes formes : un schéma, un diagramme, un dessin, un modèle en barres, etc. Cette phase intermédiaire est essentielle pour atteindre la phase d’abstraction. Or ce que j’observe souvent, c’est que cette phase n’est pas toujours bien pensée. Les élèves ne voient pas toujours le lien entre la manipulation qu’ils viennent de faire et les phrases mathématiques, écrites en symboles, qu'on leur demande d'écrire.
Et tout au long de ces trois phases d’apprentissage, la verbalisation est clé, par le professeur comme par l’élève. Le pédagogue psychologue Lev Vygotsky a en effet établi que les connaissances se construisent dans le dialogue. Traditionnellement, dans les séances de mathématiques, l’enfant était finalement peu invité à verbaliser lui-même, à raconter comment il a fait, ce qu’il en pense… Il restait passif face au professeur qui enseignait. C’est en train de changer, heureusement. Ça doit être une danse. L’élève fait un pas, j’en fais deux. Il fait deux pas, j’en fais un. C’est un échange !
La clé de la méthode est donc de donner à l’enfant les moyens de devenir acteur de son apprentissage ?
Exactement. Ce n’est pas pour rien que la résolution de problèmes et la modélisation sont au cœur de l’apprentissage à Singapour. Nous devons être des « résolveurs de problèmes » et cesser d’être uniquement focalisés sur les réponses « justes » ou « fausses ». Ce qui est important, c’est de se demander : « Quelle est ma stratégie ? Qu’ai-je fait pour atteindre ce résultat ? A quoi ai-je pensé ? Comment ai-je résolu ceci ? ». Si je suis consciente de ce que je fais, de pourquoi je l’ai fait, je pourrais mieux faire le transfert à d’autres contextes.
Être bon en mathématiques ne se réduit pas à savoir résoudre une équation ou connaître les algorithmes de calcul. Oui, bien sûr, les savoir-faire sont importants. Mais tous ces enfants, adultes demain, utiliseront des machines pour calculer, pour simuler, pour produire des informations ... Ce qui compte, c’est de leur apprendre à réfléchir, à raisonner, à analyser, à comparer, à résoudre des problèmes. Il faut cultiver chez tout enfant un niveau de réflexion bien plus élevé que la simple exécution d’opérations, de procédures, de règles.
Prenons un exemple avec les tables de multiplication. On peut les apprendre par cœur, et, bien sûr, il faut les connaître. Mais si je demande à un enfant de CE2 de voir s’il peut utiliser ce qu’il connaît déjà pour calculer 7*9, qu’il n’a pas encore appris… Il peut me dire qu’il connaît déjà la table de trois. Il sait que 3*3 = 9, il sait que 7*3 = 21. Si je l’encourage à voir les liens, il va peut-être penser à faire 7*3 trois fois, ou 21 + 21 + 21. Et ça se calcule très bien de tête : 20 + 20 + 20, c’est 60 et 1 + 1 + 1, c’est 3. Ça donne 63 ! Voilà le genre de lien qu’il faut faire quand on apprend. On retient mieux quand on voit des relations entre les faits, pas des faits isolés.
Cela nous amène à la métacognition, qui est l’un des éléments importants de la méthode. Il y a un dédoublement entre l’enfant qui « fait » -qui calcule, construit, trace, résout, etc.-et l’enfant qui se regarde faire. Cela lui permet de comprendre ce qu’il fait, pourquoi il le fait et de savoir expliquer comment il a fait. C’est une étape qui lui permet de devenir un penseur mathématique.
Vous évoquez souvent l’importance du plaisir dans les mathématiques. Pouvez-vous développer ?
L’attitude compte beaucoup dans la réussite. Elle doit être positive, empreinte de persévérance et de confiance : « Je sais qu’avec le temps je vais trouver et que si je me trompe, ce n’est pas grave ». Une erreur est un outil d’apprentissage.
Mais si on est humilié, si on nous pointe systématiquement nos erreurs, on est blessé et on peut « se fâcher » avec les mathématiques. Les émotions trop négatives nous empêchent d’accéder à nos capacités analytiques, qui sont pourtant là. Les enfants disent alors « être nuls en maths » ou « ne pas aimer les maths ».
Plus largement, quand les mathématiques deviennent une litanie de formules, de définitions, de procédures, de « comment on fait », sans aucun « pourquoi », alors c'est le début de la fin de l’amour pour les mathématiques.
Et ça, c'est un crime intellectuel. L’enfant n’a même pas encore goûté aux vraies mathématiques. Quand tu comprends, quand tu vois un lien - indépendamment de trouver le résultat -, il y a une jubilation, une joie absolue. Le cerveau humain aime voir le sens des choses, la corrélation, la causalité. C’est ça la beauté des mathématiques.
Comment transposer cette méthode en France ?
Les enfants à Singapour ne sont pas différents des nôtres. Ils ont les mêmes désirs, les mêmes caractéristiques, les mêmes compétences et les mêmes curiosités en mathématiques. Ce sont des enfants ! Nos enfants peuvent aussi être les meilleurs au monde.
Il faut cependant bien les accompagner. La méthode, le programme, les manuels, c’est bien. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut de la formation, autant initiale que continue. Et changer notre rapport à l’erreur, notre façon de concevoir ce que veut dire « être bon en mathématiques », notre façon d’enseigner.
Cela impliquerait aussi d’adopter la « pédagogie de la maîtrise ». En France, aujourd’hui, l’enseignement n’est pas séquentiel : on voit l’addition au chapitre un, puis quatre, puis six… À Singapour, ils entrent dans un chapitre pour y rester cinq, sept, voire dix jours. Ils vont en profondeur, pour permettre de comprendre chaque étape.
Singapour, la pensée algébrique est introduite très tôt, dès les petites classes. Penser algébriquement, c’est voir des connexions, des structures. On manipule des cubes pour comprendre les chiffres pairs ou impairs. On peut « voir » avec les modèles de cubes, puis comprendre, que la somme de 2 nombres pairs comme la somme de 2 nombres impairs est paire. Ces images mentales construites au primaire les aideront en algèbre pour la suite.
Il faut cependant pour cela qu’il y ait une cohérence dans une école de classe en classe. Qu’on ait un langage mathématique et une culture mathématique communes. On ne peut pas adopter la méthode pour une seule classe, un seul niveau.
Dès le lendemain des déclarations de Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale, j’ai été contactée par plusieurs académies pour donner des formations. L’intérêt est là !
Actualité · Collège, lycée